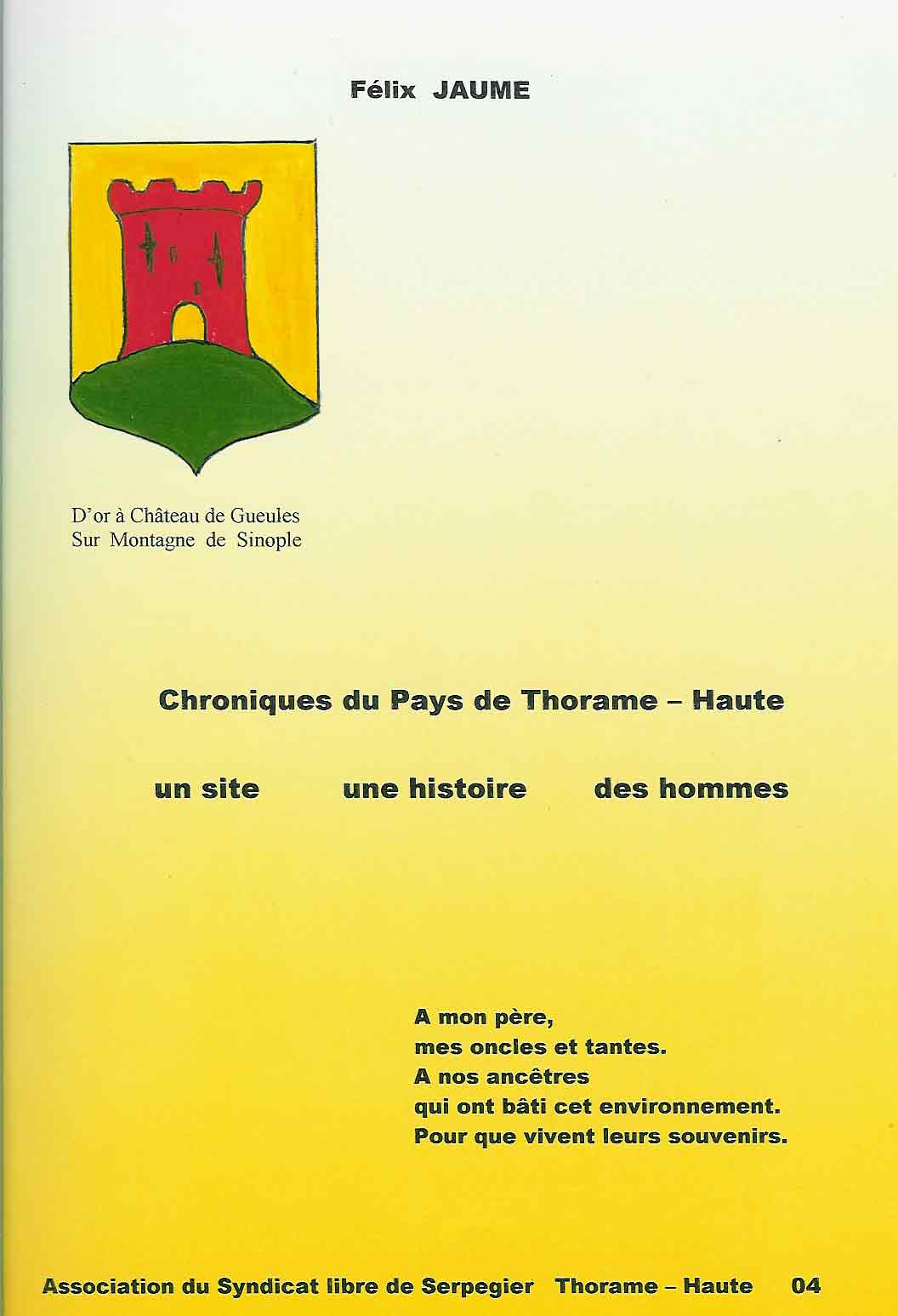
L'édifice religieux le plus ancien connu sur la commune de Thorame-Haute est celui de la chapelle de ND du Serret. Elle est située au quartier des Aires - ancien site présumé de Eturamina (Thorame-Haute) sur les hauteurs dominant le village actuel. Modeste église romane au X°siècle mais certainement encore plus ancienne, elle a été citée comme prieuré, chapelle rurale ou paroissiale, dépendant des moines de Lérins ou rattachée à l'Abbaye de Saint Victor à Marseille. Compte tenu des divers textes d'archives citant la place prépondérante qu'elle occupa dans l'environnement du village, un paragraphe lui a été réservé en fin de chapitre à la page 41.
A quelques kilomètres en amont de Thorame-Haute sur la rive gauche
du Verdon se trouve le hameau d'Ondres. Probablement érigée
en 1624, la chapelle St Laurent dédiée au Saint est mentionnée
en 1697. Elle devient « succursale »en 1686 et desservie par
le vicaire de la paroisse. Bien qu'en 1785 la nef fut agrandie, elle devient
vétuste et exiguë. L'église N.Dame lui succède.
En 1865, suivant un rapport administratif, l'église est jugée
humide et mal.saine par son exposition et insalubre pour la population. Les
murs se dégradent et présentent des lézardes. Elle se
trouve dans un état voisin de ruine et n' est plus assez spacieuse
pour contenir les fidèles du hameau. Sur des plans de l'architecte
Raymond un devis fut établi en 1. 868 pour sa reconstruction. Au nord-ouest
du hameau, sur un terrain acheté à Jean Florens les travaux
sont confiés à Pascal. Simian puis à Gabriel Chaillan.
Ils durèrent de 1871 à 1873.
Le 20 octobre 1745, le conseil réunit par maître J. Richard lieutenant
de juge de Thorame Haute, maître J.Pierre Isnard notaire royal et greffier
de la juridiction de Thorame Haute ont délibéré « pour
que le hameau d'Ondres ait un prêtre pour desservir la chapelle St Laurent »
D'autres chapelles ont occupé une place dans la communauté religieuse
du village.
* Tout d'abord la chapelle St Joseph, modeste chapelle de 3 mètres
sur 4 mètres, située à la sortie dû village sur
la route du Jas et du pont Clôt. Sa façade est ouverte par un étroit
passage entre deux murettes sur lesquelles s'appuie une baie en plein cintre.
Elle est fermée de barreaux en bois à claires-voies.
Nécessitant des travaux d'entretien, Le 19 germinal an 12 ( 09.04.1804
) les travaux sont exposés au conseil du jour « a la chapelle
St Joseph quatre cannes de planches de mélèze ( 10 mètres
linéaires) pour réparer le toit, le battant du bas de la porte...
... autre petite réparation de chaque coté de la balustrade en
mortier et à remplir au coté où le grillage est tombé...
...». A ce même conseil et le même jour, même réfection
pour la chapelle St André au Riou « a bâtir sur le devant
un mur d'environ 14 pans (environ 3,50 m. ) et pratiquer deux petites fenêtres
une de chaque coté de la porte de deux pans et demi de hauteur (environ
O,75m:)...»
* Enfin, au nord est du village, en bordure du chemin muletier conduisant à la montagne de Cheinet, se trouve la chapelle St Roch. Construite probablement entre le 17° et le 18°siècle, sa nef est voûtée en berceau brisé. Elle a servi de poste de garde d'un cordon sanitaire mis en place durant l'épidémie de peste de 1720. Au cours de récentes rénovations, il a été découvert sous une couche de chaux quelques graffiti et signatures de volontaires à cette garde y ayant séjourné.
* Deux autres chapelles, aujourd'hui disparues, sont mentionnées dans les archives. La chapelle St Louis en 1712 au hameau de la Rivière, l'autre en 1785, la chapelle St André au Riou quartier actuel du village. Plus proche de nous, érigée en 1826, la chapelle des pénitents blancs, aussi appelée chapelle St Pierre. Située dans..la rue portant le même nom, elle est aujourd'hui désaffectée et est devenue une salle communale.
Tous les ans, pour le lundi de Pentecôte, se déroule le pèlerinage
de ND de la Fleur très connu dans toute la vallée et le département
donnant lieu à un important cérémonial religieux. La statue
de la Vierge à la Fleur, portée sur un socle par deux hommes
se relayant à l'aller comme au retour, est amenée de l'église
paroissiale où elle se trouve habituellement à la belle et récente
chapelle de ND de la Fleur située à environ sept kilomètres
du village" au lieu-dit de Thorame-Haute gare sur la RD 955 allant vers
St André les Alpes.
Au 18° et 19° siècle, un hôpital était en place dans la commune. .Il se situait semble-t-il dans la grande bâtisse ( immeuble Brieu ) sise dans la grande rue, à la sortie du village, sur l'ancien chemin de Colmars. Nous avons connaissance de son existence par des rapports d'archives, mais aucun renseignement sur son installation, son fonctionnement, son importance. .Il recevait des dons, des legs de diverses origines tel celui mis à la disposition de ses administrateurs, en 1789, par le Prévôt de Senez.
« ... .ayant eu le malheur, Monsieur, de perdre mon frère le
prévôt de Senez, je vous donne avis ainsi que par son testament
du 31 janvier 1784, notaire Richard à Manosque, il a légué à l
'hôpital de Thorame-Haute la somme de 1 000 livres payable de l'année
de son décès ... ". j'ai remis à Maître Sauvan
notaire royal la dite somme ... ... .afin qu'il fasse courir les intérêts
en faveur de l 'œuvre. J'ai recommandé de plus de ne rien retenir
pour les droits d'insinuation. Je vous prie de faire faire un quittance publique
au plus tôt dont vous remettrez l'extrait à monsieur Sauvan. J'ai
l'honneur ... ... ... ... ..
.l'abbé de Figuières
A cette époque où le geste et la parole étaient les seuls moyens d'expression pour l'ensemble de la population, une perspective de développement se perçoit avec l'écriture et la lecture, moyen de communication dont l'usage était toutefois réservé à une certaine classe de cette communauté.
Au XVIl°XVIII° siècle, peu de gens savaient lire et écrire et peu savaient signer. Les registres paroissiaux mentionnent souvent cette remarque au bas des actes de vie. Aussi, à cette époque pour communiquer par un « écrit }} fallait-il avoir recours à un spécialiste, un « maistre escrivain descriture }}. Les archives judiciaires en mentionnent un à Thorame-Haute avec Me Alexandre Isnard qui exerçait en 1703. Il serait l'un des derniers de la vallée.
Pour les profanes qui étaient la grande partie des ruraux de cette région, l'écriture et sa lecture restaient indéchiffrables et secrètes. En outre, pour une rapidité d'exécution, et préserver certainement un domaine quasi professionnel, le scribe ou le maître écrivain utilisait des abréviations, des codes de signes qui en compliquaient l'utilisation et la pratique. Cette même garantie était déjà utilisée peu avant l'ère chrétienne par Tullustiro dit Tiron, esclave affranchi et secrétaire de Cicéron et inventeur d'un système de Tachygraphie (notae Tironianae ) qui porte son nom, utilisant quelque 13 000 ou 14 000 signes ou notes composant son système de vocabulaire. Très utilisé dans la paléographie moyenâgeuse, usité au XVIO et xvn° siècle, ce vocabulaire disparaîtra peu à peu au XVIII° siècle. Par contre, les chercheurs en histoire, les paléographes amateurs ou professionnels utilisent ce système pour la transcription des textes anciens. Quant à la calligraphie des lettres, aux caractères de l'écriture, ils se sont présentés au cours des siècles avec des formes particulières, passant de la Caroline (IX° X° siècle) à la Batarde (. XII°XIV° siècle) pour aboutir à la cursive, forme d'écriture que nous utilisons actuellement.
Il faut toutefois attendre le XIII° / XIV° siècle pour que des textes d'archives permettent de prouver l'existence d'écoles primaires dans nos campagnes. Sous l'ancien régime, si cet enseignement existait, il était laissé à l'initiative des communes sous le contrôle du seigneur du lieu mais le plus souvent sous celui du clergé. Une délibération du conseil municipal de Digne du Il.juin.1440 mentionne un ordre de paiement pour deux maîtres d'école. Le Concile de Trente ( 1545 / 1553 ) stipule que chaque église devra utiliser un maître.
On peut toutefois noter que les instituteurs des Basses Alpes étaient mieux considérés, mieux traités que ceux d'autres régions. Dès la fin du XVI° ou début du XVII° siècle, quelques écoles sont ouvertes dans le département. Le clergé les surveillait sans toutefois les diriger mais au cours des visites pastorales, les prélats exerçaient avec rigueur une inspection administrative et pédagogique auprès de l'école.
Suivant le compte rendu de sa visite pastorale du 17.10.1683, Mgr Villeserin soulignait << .et parce qu audit lieu de Thorame-Haute il n’y a aucun maistre d’escolle pour L’instruction de la jeunesse nous avons ordonné qu'a la diligence des consuls et communauté dudit lieu il nous en sera présenté un lequel jugeant capable sera admis. et ce dans la trentaine et à faute de le faire dans le temps nous. y pourvoyerons d'un appointement qui sera par nous réglé conformément aux Ordonnances et arrêts de sa Majesté. . . ... »
Cette perspective de développement perçue avec l'écriture et la lecture est .sensible au milieu du xvrn° siècle avec l'apparition des structures de l'enseignement. Peu de renseignements sont connus sur la manière dont étaient dispensées ces études élémentaires. La Haute Provence se place à un rang honorable parmi les anciennes provinces françaises à cette mise en place et ce, malgré la précarité des communications et de son économie fragile.
En l'absence d'un maître d'école officiel, il était fait
appel aux ecclésiastiques de la paroisse ou de la succursale ou bien à des
laïcs parfois rétribués par la commune par un contrat de
louage. Le plus souvent l'école occupait le coin d'une écurie
Les élèves, assis à même la terre ou parfois sur
un banc et dans des positions peu confortables, prenaient place à coté du
bétail apportant le « chauffage ». Un morceau de planche
servait de pupitre. Lorsque la classe se faisait dans un local qui servait
aussi de logement à l'instituteur, les écoliers apportaient eux-mêmes
des bûches pour le chauffage ou allaient avec l'instituteur à la
recherche de bois mort. Au début de notre siècle, vers 1900,
les familles fournissaient deux charges de bois ( 330 kg ) par enfant en scolarité.
Le support était l'ardoise car le papier était rare et cher.
Le moyen d'écriture étant la craie, après chaque travail
l' écolier effaçait et en recommençait. un autre. Les
livres étaient souvent sales ou déchirés. Appartenant
parfois à la famille de l'élève, ils servaient d'année
en année se transmettant de père en fils.
L'école commençait aux premiers froids de l'hiver, après la fin des travaux aux champs pour se terminer aux débuts des labours et il n'était pas rare que certains écoliers, parmi les plus grands, s'absentaient en cours d'année pour accomplir des activités utiles à la vie familiale. Les matières enseignées étaient l'écriture, pour laquelle nos ancêtres étaient très attachés, l'arithmétique avec les quatre opérations, quelques notions d'histoire et de géographie, mais surtout la pratique de la lecture des vieilles écritures qui n'était pas à la portée des villageois. Enfin quelques notions de grammaire complétaient cet enseignement sans oublier la récitation du catéchisme et de l'histoire sainte sous la férule du curé de la paroisse.
En 1775, J. André Richard tient une école à Thorame-Haute
En 1840, Alexandre Léon Richard, instituteur à Thorame-Haute, est félicité par l'inspecteur d'académie Dupuy-Montbrun pour avoir, en marge de son programme, enseigné le latin à ses élèves.
La discipline et le règlement étaient sévères voire rigoureux et les châtiments étaient fréquents. Lorsqu'un écolier avait manqué au règlement ou avait été l'instituteur lui octroyait une rossée avec l'extrémité recourbée d'une canne ou autres triques Pour les fautes moins graves, l'enfant étaient mis à genoux sur l'arête d'un . les bras en croix en tenant un livre dans chaque main. Mon père se souvient d'avoir été de cette manière par monsieur Borel un vieil instituteur très sévère. Le matin en rentrant les enfants, se mettaient sur le banc à genoux pour réciter la prière. Mon père avait six ans et c’était 1900.
Les instituteurs étaient recrutés soit par la commune soit à la
foire aux maîtres d'école. Telle celle qui se tenait à Barcelonnette
le 30 septembre. Parfois ils allaient eux- même offrir leurs services à la
commune. Tous avaient un semblant de tenue. Ils étaient vêtus
d'une jaquette légendaire en étoffe grossière, chaussés
de lourdes chaussures cloutées, souvent surmontées de guêtres.
Coiffés d'un chapeau, il en déterminait son instruction: une
plume d'oie l'instituteur enseignait l'écriture ~ à deux plumes
s'ajoutait le calcul. La troisième plume était réservée
au plus savant avec l'enseignement du latin.
A la séance du conseil du 27.12.1710 ledit conseil propose:
« qu 'en exécution du pouvoir à eux donné par les
précédentes délibérations du conseil ils ont loués
un maistre d'école pour instruire et enseigner la jeunesse du lieu a commencé par
la feste de la Toussaint dernière jusqu'au milieu du mois de may prochain
aux gaigesde trente livres requerant daprouver le louage dudit maitrtre descole
aux susdits gaiges et ordonné que diceux en sera fait mandat sur leur
trésorier »
Qu'ils soient recrutés aux foires annuelles ou par la commune elle-même, un examen sanctionnait ce recrutement. Il consistait à la lecture, la compréhension des vieux textes, des connaissances générales sur le calcul, grammaire. Un tracé de leur signature et un paraphe élégant étaient un atout pour les décisions du jury. Ce jury était composé en premier lieu du curé de la paroisse très influent sur sa nomination, assisté du maire, du conseil et consuls ainsi que des gens les plus importants de la commune.
Avant la révolution, l'avis du clergé était sans appel pour souligner la part réservée à l'enseignement religieux. Aussi il arrivait que l'instituteur suppléait le desservant de la paroisse par des travaux secondaires. Parfois pour arrondir son salaire dérisoire, il vaquait à d'autres activités en fonction de son instruction ou de ses capacités telles que notaire, secrétaire de mairie, maçon, cordonnier ou le travail de la terre. Se situant au bas de l'échelle sociale, l'instituteur de l'époque de l'ancien régime se plaçait au rang du berger communal. Sur son salaire, peu de renseignements. Us sont vagues et variaient d'une commune à l'autre. En règle générale la rémunération est faible. Elle peut être augmentée d'un règlement en nature: blé - viande - repas -, ou autre avantage - logement si le recrutement se faisait par la commune -.Mais parfois des procès sont intentés par suite de non respect du règlement aux intéressés comme aux employeurs.
Telle semblait être la description de l'école primaire dans les Basses-Alpes sous l'ancien régime c'est à dire laissée à l'initiative de la commune.
Après la révolution, la première organisation de l'enseignement primaire se signale avec Talleyrand à la Constituante et Condorcet aux Législatives, par un projet de la Convention en 1792 et à la loi du 24.10.1795. Entre temps, avec les décrets du 15.09 et du 21.10.1793 et par la suite par le décret impérial du 17.03.1808, de grandes lignes se dessinent au bénéfice de l'enseignement supérieur et universitaire, tout en ignorant le développement de l'école primaire. Par contre l'ordonnance royale du 29.02.1816 place officiellement les écoles primaires sous la direction du clergé, sans mesure financière assurée. Les écoles fonctionnent suivant les possibilités locales, laissées aux soins de l'église et des notables locaux. Ce n'est qu'en 1833, le 28 juin, que la loi Guizol assure aux communes des fonds nécessaires pour la mise en place des écoles communales, un traitement, une stabilité aux instituteurs, mais aussi une formation avec la création des écoles normales. ( celle de Barcelonnette date de 1833 ). Dans le département, le nombre d'instituteurs commun:aux passe de 18 en 1835 à 66 en 1846.
En juin 1818, dans l'ordre du jour du présent conseil, le maire relève le manque d'écoles primaires et d'effectifs. La population est de l'ordre de 796 habitants et le conseil municipal considère que l'an dernier plus de 30 garçons n'ont pu aller à l'école faute de places et d'instituteurs. Alors qu'une école vient de fermer ses portes, la commune employait auparavant deux, voire trois instituteurs dans un seul local.
« ... .plus de trente écoliers sont discontinus d'étudier ... ..depuis ce temps les habitants n'ayant pas porté de plainte je vous invite à délibérer sur un sujet aussi intéressant afin d'obtenir le rétablissement d'une deuxième école primaire ... ..»
Le maire signale ensuite «... ... considérant qu'un seul instituteur
puisse
soigner tous les écoliers de la commune qui sont 70 et considérant
que quand même
l'in5.tituteur actuel prendrait des adjoints il y aurait aucun appartement
qui put contenir le nombre d'écolier.. ... ..considérant enfin
qu'il est bien difficile pour tout individu de réunir la confiance générale
et qu'il est reconnu que quoique l'instituteur actuel fasse son possible pour
le mériter, il est plusieurs personnes de la commune qui préfèrent
de ne pas faire étudier leurs enfants que de les savoir à son école...
... ... A délibérer de demander à Monsieur le Préfet
de rétablir une seconde école primaire et qu'il autorise le maire à procurer à la
commune un instituteur et lui faire délivrer un diplôme par Monsieur
le Recteur de l'Académie Royale d'Aix »
Au conseil municipal du 2 janvier 1819, le maire expose un autre problème scolaire concernant l'éducation des jeunes filles. Elles ne peuvent être réunies avec les garçons en exécution de l'article 32 de l'ordonnance du 28 février 1816 et le manque d'institutrices pour les encadrer.
« ... ... Monsieur le maire expose que l'éducation des filles
n'étant pas moins essentielle que celle des garçons, il convient
sous tout les rapports d'établir deux
institutrice.~ '" ... que si la commune est privée d'institutrices
il en résulte que les filles. ne
peuvent plus rien apprendre, on verrait dans quelques années qu'aucune
mère de famille ne saurait élever ses enfants et ne saurait peut être
leur enseigner à croire en Dieu... ". ..de propager l'enseignement
et que cette mesure doit être comme aux filles comme aux garçons.
Conséquence, le conseil délibère à l'unanimité que
la Dame Marie Louise Marc et la Demoiselle Claire Pans doivent être autorisées
d'enseigner dans ladite commune ." .»
En conclusion de ces deux rapports alarmants, certainement« entendus »par les autorités départementales, en 1820 il Y avait dans la commune 5 écoles dans lesquelles étudiaient 80 garçons et 74 filles.
En terminant ce paragraphe dans le cadre de l'école communale, rappelons que la gratuité de l'enseignement primaire est établie par la loi du 16.06.1881, que la loi du 28.03.1882 en détermine l'obligation à tous les enfants de 6 ans à 13 ans, enfin, que depuis le 30.10.1886, l'enseignement dans les école communales est assuré par des laïques.
Documents recueillis grâce
aux
|
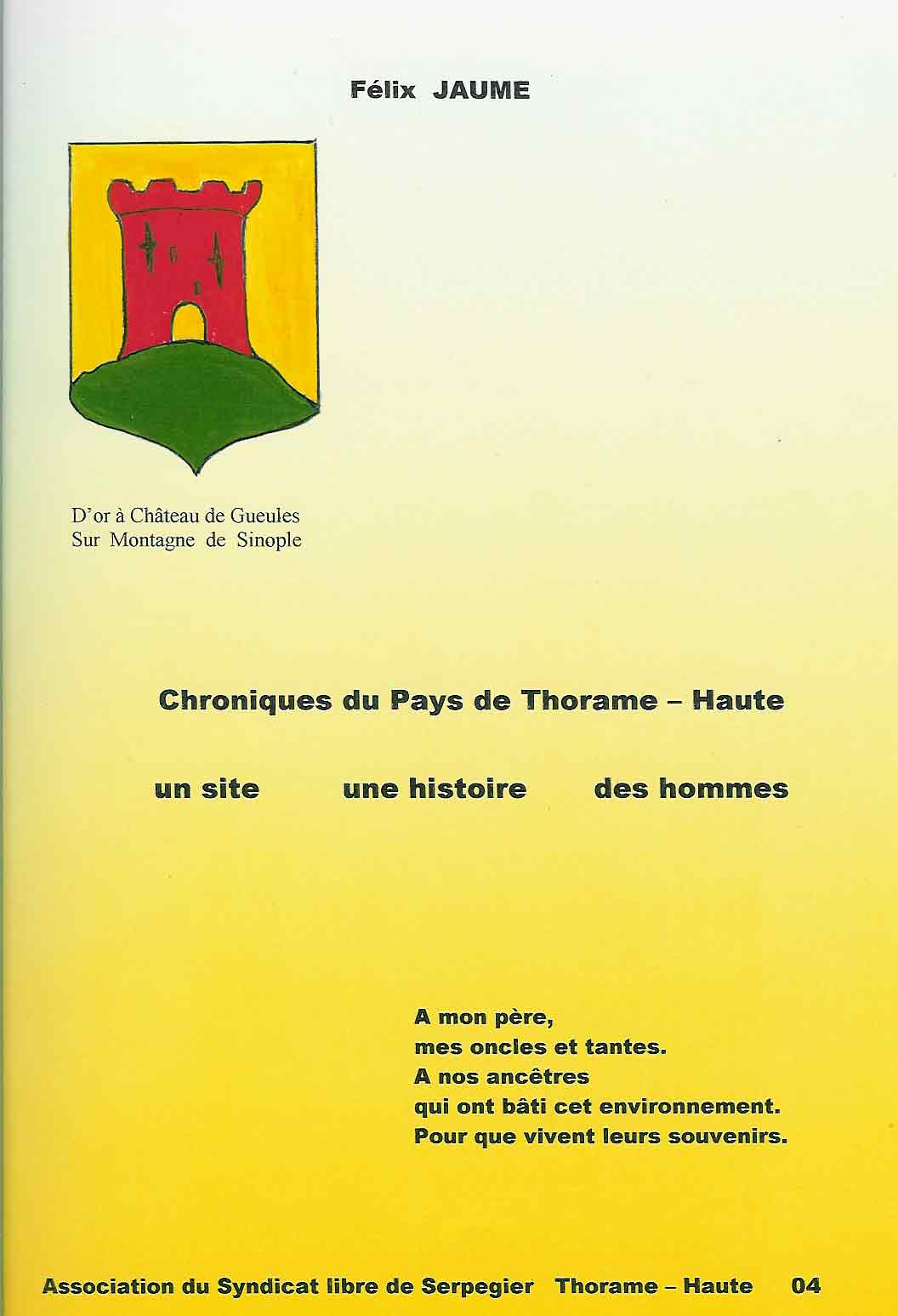 |
Chroniques du Pays de Thorame-Haute
|
|
de M Félix JAUME
|